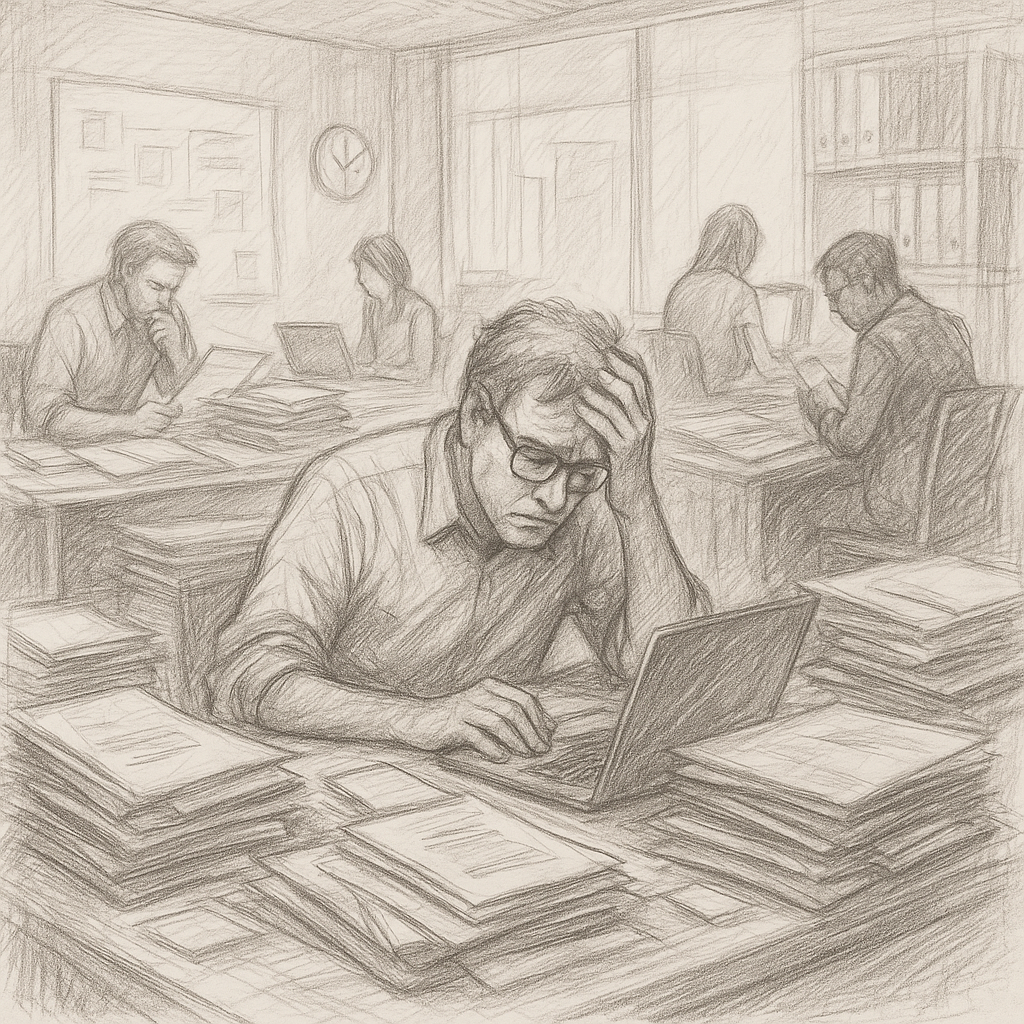Il y a des moments où une organisation ressemble à un buffet à volonté : projets d’innovation, refontes numériques, nouvelles plateformes, partenariats, POC d’IA… Tout semble urgent, tout paraît stratégique. Résultat ? Trop d’initiatives, peu de résultats tangibles, des équipes épuisées.
Si vous vous reconnaissez, vous n’êtes pas seul. C’est le symptôme d’une transformation sans gouvernail clair.
Ce qui se passe vraiment
Quand trop d’initiatives s’empilent, trois phénomènes apparaissent :
- Dispersion — chaque équipe pousse dans sa direction, sans alignement.
- Effet “magasin de bonbons” — on dit oui à tout ce qui brille, sans penser aux limites de capacité.
- Manque de clôture — les projets ne s’arrêtent jamais vraiment, ils s’éternisent et grugent des ressources.
Le problème n’est pas le manque d’idées, mais l’absence d’un langage commun pour décider quoi lancer, quoi arrêter, et pourquoi.
Les erreurs fréquentes
- Tout traiter comme un projet stratégique : on surcharge les comités de direction avec des sujets qui pourraient être réglés ailleurs.
- Prioriser par intuition : l’idée la plus récente ou la plus bruyante prend le dessus.
- Reporter la décision de “tuer” : personne ne veut assumer qu’une initiative ne vaut plus l’effort.
Ce qui marche
Les organisations qui réussissent à concentrer leurs énergies appliquent quelques principes simples :
- Cartographier les capacités
Plutôt que de lister des projets, commencez par nommer ce que l’entreprise doit savoir faire pour livrer sa stratégie : vendre en ligne, livrer en 24h, intégrer des partenaires, fidéliser les clients…
Chaque projet doit renforcer au moins une de ces capacités. Sinon, c’est un drapeau rouge. - Distinguer initiatives et paris
Une initiative exécute ce qu’on sait déjà. Un pari explore l’inconnu. Les deux sont utiles, mais ils ne se pilotent pas de la même façon. - Mettre en place un “kill switch”
Avant de lancer, définissez les conditions d’arrêt. Exemple : si après trois mois le POC IA n’a pas trouvé d’usage concret, on arrête. Décider d’avance évite les projets-zombies. - Revoir régulièrement, pas une fois par an
Les arbitrages stratégiques ne se font pas seulement au budget annuel. Une rencontre trimestrielle, avec cartes et critères partagés, permet d’ajuster la trajectoire.
Exemple concret
Une PME manufacturière avait dix initiatives en parallèle : ERP, CRM, automatisation d’usine, expérience client, virage e-commerce, etc. Les équipes couraient partout, sans voir de résultat.
En cartographiant les capacités, trois priorités réelles sont apparues :
- Automatiser la planification de production.
- Stabiliser le CRM pour fiabiliser les données clients.
- Lancer un pilote e-commerce limité.
Le reste a été mis en pause. Trois mois plus tard, les premiers bénéfices étaient visibles : temps de cycle réduit, meilleure qualité de données, premières ventes en ligne.
Mesures qui comptent
- Taux d’initiatives arrêtées proprement (oui, c’est un signe de maturité).
- Nombre de capacités renforcées par projet (plutôt que livrer “quelque chose”, livrer “mieux savoir-faire”).
- Satisfaction des équipes : moins de dispersion = plus de sens.
Et après ?
Reprendre le contrôle des initiatives, ce n’est pas dire non à l’innovation. C’est créer l’espace pour qu’elle produise enfin de l’impact.
La question n’est plus “Combien de projets avons-nous ?” mais “Lesquels renforcent vraiment notre capacité à atteindre nos ambitions ?”.
FAQ
Comment savoir si j’ai trop d’initiatives en cours ?
Si vos équipes disent régulièrement “on n’a pas le temps de finir”, que les projets n’ont pas de critères de succès clairs, ou que vous n’êtes pas capable d’expliquer en deux phrases la priorité du trimestre, c’est un signe clair.
Comment introduire cette discipline sans bloquer la créativité ?
En distinguant “paris exploratoires” des “initiatives d’exécution”. Les premiers ont droit à l’échec rapide, les seconds exigent de la rigueur. C’est le mélange des deux qui crée la valeur.